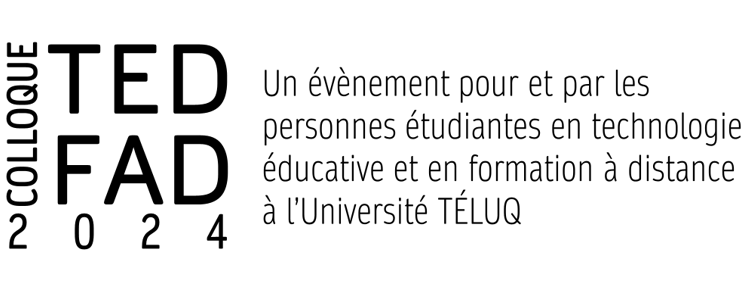Le 8 avril 2024 aura lieu de 12h00 à 16h00, le colloque TED-FAD 2024. Ce colloque virtuel est organisé par l’équipe professorale en technologie éducative (TED) et en formation à distance (FAD) de l’Université TÉLUQ, en collaboration avec le centre de recherche i-TEQ.
Des étudiantes et des étudiants des programmes en TED et en FAD présenteront les fruits de leur mémoire ou de leur essai (terminé ou en voie de finalisation), des résultats de travaux de recherche dans lesquels ils ou elles ont travaillé, ou même des travaux réalisés dans leur cours digne de mention.
Programmation détaillée
12h00 – Odyssée numérique, un exemple de recherche et développement par Patrick Plante
Cette communication, qui prend la forme d’un partage d’expérience, présente le développement du jeu sérieux Odyssée numérique, un jeu sur la compétence numérique. À partir de besoins identifiés par l’UQ et soutenus par le MES, ce projet a été développé par des participants de toutes les composantes de l’UQ et de Lucid Tales, une coopérative de travail spécialisée dans le développement de jeux vidéo. Notamment, nous nous attarderons à l’utilisation d’un jeu sérieux en contexte universitaire ainsi qu’à l’idéation du projet, l’intégration du public étudiant dans le processus ainsi que la négociation entre les impératifs pédagogiques et les limites techniques et ludiques. Nous présenterons également quelques leçons de notre expérience ainsi que de prochaines étapes possibles.
12h30 – Projet Contact par Karine Tremblay
Le projet Contact qui s’est déroulé lors des trimestres d’automne 2022, d’hiver 2023 et d’automne 2023 a permis de constater qu’il existe un besoin chez un certain nombre d’étudiant.es à l’Université TÉLUQ de participer à des rencontres de démarrage collectives synchrones dans leurs cours. Un autre volet de ce projet concerne les besoins d’encadrement des étudiant.es dans leurs cours, principalement davantage à propos des besoins liés à l’encadrement à distance.
Ainsi, tous les étudiants inscrits (n= 278) aux cours ayant été ciblés pour les rencontres de démarrage ont été invités à participer à une rencontre de discussion (focus-group) avec d’autres étudiant.es afin de partager leur expérience en tant qu’étudiant.e à l’Université TÉLUQ. Lors de cette communication, les résultats obtenus lors des rencontres de discussion seront présentés.
13h00 – Outil de planification et de suivi de développement professionnel pour le personnel enseignant par Caroline Dupuis
Face à l’abondance de formations en intégration du numérique en classe, il est de plus en plus difficile pour les enseignants de faire des choix judicieux. Dans le but de les soutenir à travers leur parcours de développement professionnel (DP), il semble pertinent de concevoir un outil de planification de DP numérique. Cet outil vise à amener les enseignants à identifier leurs besoins en DP, sélectionner des formations judicieuses et de qualité, ainsi que maximiser l’impact de leur DP sur la réussite des élèves. Il propose une série de questions à chaque étape de la planification du DP pour guider chaque utilisateur dans leur réflexion et les diriger vers des formations adaptées. Son utilisabilité a été testée auprès de groupes d’experts et d’enseignants. Plusieurs recommandations ont été tirées de cette recherche dans le but d’améliorer l’outil créé. Cet outil a le potentiel d’être une ressource intéressante pour les enseignants et les conseillers pédagogiques RÉCIT qui les accompagnent, contribuant à un développement professionnel plus efficace et efficient en lien avec le numérique.
13h30 – L’intégration des technologies en éducation : la place centrale de l’analyse du besoin par Pierre Célestin Taptué
L’intégration des technologies en éducation est de nos jours une préoccupation centrale dans la conception et la mise en œuvre des systèmes éducatifs. Cette exigence à pour préalable, une analyse du besoin qui va permettre de confirmer son utilité voire sa nécessité. Le présent article nous donne l’occasion d’énoncer la démarche à suivre pour s’imposer une bonne analyse de besoin et espérer garantir l’effet et l’impact sur les méthodes et les pratiques des enseignants. La description des étapes clés de l’analyse nous permet de proposer en premier, l’élaboration de la problématique, du contexte et de la justification du projet dans lequel le chercheur s’engage à l’identification du besoin en outils ou en technologies éducatives. Cette étape devrait se terminer par une bonne identification de la question ou de l’objectif principal du projet. Le cadre théorique qui doit être présenté en second lieu permet de cerner le besoin effectif d’une formation bien spécifique pour le public cible. L’étape de présentation de la méthodologie à suivre permet de rassurer le concepteur pédagogique, le mandataire ou le bénéficiaire sur la maitrise par le chercheur du public cible. La conception et l’administration des instruments de recherche, la collecte et le traitement efficace des données préparent l’exploitation des résultats. Une bonne analyse des résultats obtenus permet de conduire une discussion et de terminer par la formulation des recommandations sur le déploiement de la solution retenue.
14h00 – Le Portail Kwe l’Université! Pour vous préparer aux études universitaires et vous accompagner dans votre parcours par Isabelle Savard
Ce projet résulte de la mise en commun des expertises de trois universités, soit l’UQAC (Centre des Premières Nations Nikanite) et l’UQAT (École d’études autochtones), en accompagnement d’étudiants autochtones, et la TÉLUQ, en formation à distance et technologie éducative. Il porte sur le design pédagogique participatif d’une propédeutique à distance à l’attention des Autochtones.
Nous avons d’abord mené une analyse qui nous a permis de faire différents constats qui servent d’ancrage au projet de Portail. D’abord, l’université, qui porte parfois le seau d’une discontinuité culturelle pour bon nombre d’Autochtones, contribue au choc que plusieurs étudiants vivent en arrivant aux études supérieures. Ensuite, certains Autochtones doivent composer avec des défis pédagogiques peu définis dans la littérature et non accompagnés de solutions. Enfin, on constate aussi que de nombreux étudiants autochtones entreprennent des études universitaires après une pause de parfois plus de cinq ans dans leur parcours scolaire.
Dans cette situation, certains ont pu perdre des compétences nécessaires à l’exercice du métier d’étudiant. Le but ultime de la propédeutique, intégrée au Portail Kwe l’Université! , est d’aider ceux et celles qui jonglent avec l’idée d’entreprendre des études universitaires à développer ces compétences, à distance, sans qu’ils aient à quitter leur communauté. Puisque l’accès à Internet n’est pas stable dans toutes les communautés, nous avons préparé, en plus de la version en ligne des cours de la propédeutique, une version « en boîte » qui assurera l’accès aux contenus sans dépendre d’une connexion à Internet.
Les différentes consultations menées dans le cadre de notre analyse ont également permis de prioriser les thèmes des trois premiers cours (1 crédit chacun) qui seront offerts. En effet, nous allons bientôt mettre à l’essai, dans quatre communautés autochtones partenaires, une partie de notre « propédeutique en boîte », pour ceux et celles qui ont un accès limité ou inexistant à Internet, ainsi que de notre « propédeutique en ligne ».
Au cours de cet présentation, nous allons présenter les résultats de notre analyse, notre démarche de design participatif ainsi que les cours développés.
14h30 – État des connaissances sur l’utilisation de la microcertification numérique en contexte de formation continue chez les personnes enseignantes par Marie-Noëlle Marineau
La Loi sur l’instruction publique a été modifiée en 2020 afin, notamment, d’ajouter l’obligation pour les personnes enseignantes québécoises de suivre au moins 30 heures de formation continue par période de deux ans, à l’image d’autres professions. Ces activités de formation continue peuvent être de formes variées comme de la formation dite plus « traditionnelle », la participation à des événements organisés par des associations, les lectures professionnelles ou les microcertifications numériques (MCN).
Au Québec, des organismes travaillant en collaboration avec le ministère de l’Éducation proposent des plateformes d’autoformation qui permettent aux enseignantes et enseignants de développer des compétences professionnelles, notamment en lien avec le Plan d’action numérique. Ces formations en ligne sont reconnues par un badge numérique qui peut être ajouté à un portfolio numérique pour garder une trace des formations suivies.
Dans d’autres pays, l’utilisation des MCN et des portfolios numériques dans un contexte de formation continue ou de développement professionnel chez le personnel enseignant a été étudiée. Les avantages et les limites de l’utilisation de la MCN dans un tel contexte ont commencé à être identifiés. Les analyses et conclusions de ces recherches permettent de formuler des recommandations qui pourraient être utiles pour une implantation au Québec.
Cette présentation a pour but de faire l’état des connaissances sur l’utilisation de la MCN en contexte de formation continue chez les personnes enseignantes et de répondre à la question suivante : s’agit-il d’une option envisageable pour favoriser et valoriser la formation continue chez le personnel enseignant du Québec ?
15h00 – Analyse des caractéristiques des évaluations proposées dans un contexte d’enseignement supérieur à distance par Marie-Maxime Bellemare
L’évaluation des apprentissages dans le cadre d’une formation à distance est associée à des enjeux qui diffèrent en partie de celui des apprentissages en présentiel. Au fil des années, certains établissements offrant des programmes de formation en enseignement supérieur entièrement à distance ont conçu des évaluations dans un tel cadre. Cette communication vise d’ailleurs à présenter les résultats d’une enquête portant sur les caractéristiques de 237 évaluations dispensées à distance et se retrouvant dans 30 cours au sein d’un même département. La caractérisation de ces évaluations s’est faite en utilisant le document L’évaluation des apprentissages en 20 questions de Gérin-Lajoie, S., Beaupré, J., Contamines, J., Hébert, M-J. & Paquette-Côté, K. (2020). Lors de cette communication, les résultats et les principaux constats seront discutés.
15h30 – L’enseignement efficace à l’ère de l’automatisation par Patrick Bouchard
Dans le cadre d’un projet de recherche pour un essai, je me suis questionné sur la façon dont les technologies d’automatisation pourraient aider les enseignantes à faire leur travail plus efficacement. En effet, il est reconnu que les enseignantes manquent régulièrement de temps pour réaliser tout ce qu’elles ont à faire. Alors que de plus en plus d’outils technologiques utilisant l’intelligence artificielle ou des algorithmes sont disponibles pour les pédagogues, je me suis demandé comment cela pourrait réellement aider ceux-ci au quotidien à gagner du temps et à mieux faire leur travail. Pour mieux saisir la façon dont cela pourrait éventuellement s’opérer, j’ai sollicité des enseignantes de la région de Val-d’Or et près de 70 d’entre elles ont accepté de répondre à un questionnaire. Ce dernier s’articulait autour de trois thèmes : 1) l’utilisation des outils technologiques, 2) la dimension temporelle et 3) l’ouverture à déléguer des tâches. Je présenterai donc quelques constats, de même que les recommandations que j’ai formulées dans mon essai afin de conjuguer l’utilisation d’outils technologiques d’automatisation et les principes d’un enseignement efficace.